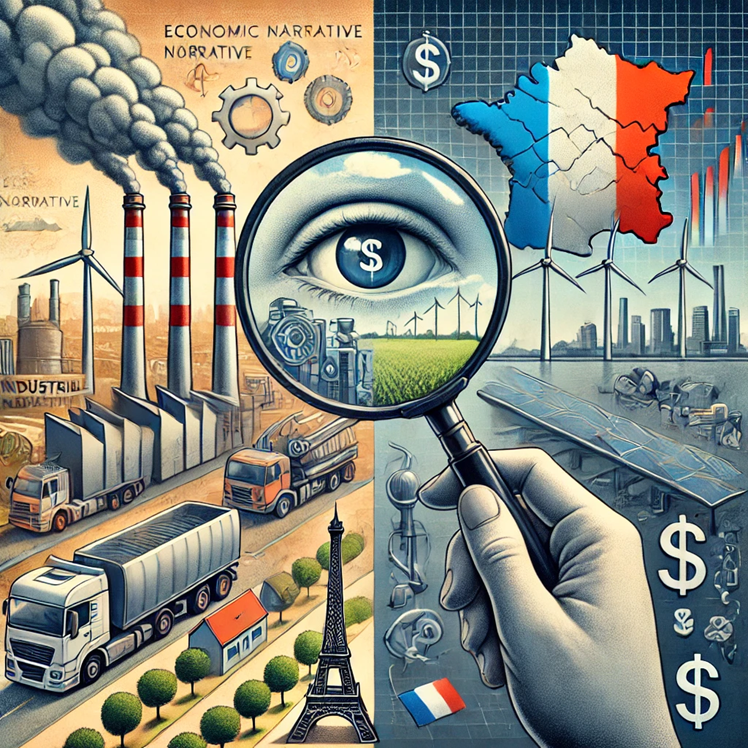Il y a quelques années à peine, au plus fort de la pandémie, c’était l’“économie de la vie” qui structurait le discours officiel : santé, alimentation, éducation, environnement… Ces secteurs essentiels devaient devenir les piliers du monde d’après. Aujourd’hui, ils sont passés à l’arrière-plan, éclipsés par le retour en grâce de l’industrie lourde, et plus encore, de l’industrie stratégique : défense, nucléaire, spatial. On a changé de récit, et ce n’est pas neutre.
1/ De l’économie de la vie à la géopolitique industrielle
Le passage est frappant : du soin à la sécurité, du vivant au blindé, du citoyen au territoire. Ce basculement est alimenté par une conjoncture internationale anxiogène : guerre en Ukraine, tensions sino-américaines, menaces sur les chaînes d’approvisionnement, choc énergétique. L’État stratège revient par la grande porte, mais il priorise les secteurs durs, ceux qui relèvent de la souveraineté défensive.
Et qui en profite ?
→ Le spatial (Thales Alenia, ArianeGroup), la défense (Dassault, Safran, Nexter), l’énergie (EDF, Orano).
→ Des filières très concentrées, déjà capitalisées, souvent très connectées à l’État et à Bruxelles.
→ Des filières… massivement subventionnées.
Ce sont elles les véritables héroïnes du récit de la réindustrialisation. Ce sont elles que l’on montre aux caméras.
2/ Et l’économie de la vie ? Enterrée sous le tarmac
L’économie de la vie — qui inclut les soignants, les agriculteurs, les enseignants, les artisans du vivant — n’a pas vu les milliards pleuvoir de la même façon. Le Ségur de la santé, malgré son nom prometteur, a été perçu par beaucoup comme un rattrapage tardif, pas une refondation. Les hôpitaux restent exsangues. Le personnel médico-social en sous-effectif. Les métiers du soin, de l’éducation, de la petite enfance ? Toujours aussi précarisés, invisibilisés.
Or, ces secteurs emploient massivement, irriguent les territoires, ont un potentiel immense d’innovation sociale et écologique… mais ne cochent pas les cases du storytelling techno-industriel. Pas assez “smart factory”, pas assez “futur de l’Europe”.
On parle beaucoup de “réindustrialisation stratégique”, mais de quelle stratégie parle-t-on, quand on laisse en friche les métiers qui tiennent la société debout ?
3/ L'économie de la vie n’est pas rentable ? Vraiment ?
Ce qui est en jeu, c’est aussi la rentabilité attendue par les décideurs publics. Une usine de batteries, ça coche toutes les cases : transition, souveraineté, emploi qualifié, export potentiel. Un EHPAD mieux financé ? C’est moins sexy sur une slide de présentation.
Et pourtant, les crises futures ne seront pas seulement militaires ou énergétiques. Elles seront climatiques, sociales, sanitaires, psychologiques. C’est là que l’économie de la vie redeviendra centrale — trop tard ?
4/ L’envers du décor : un récit genré, élitiste et partiel
Il faut aussi le dire : ce virage narratif bénéficie surtout à des filières très masculines, très techniques, très élitistes. Les grands ingénieurs de Polytechnique ne rêvent pas de devenir directeurs de crèche. Il y a un biais de genre et un biais de prestige dans la politique industrielle actuelle.
Les femmes, les jeunes, les travailleurs du care, les agents de terrain : ils sont les grands absents du récit. Alors même qu’ils représentent la colonne vertébrale du pays réel.
5/ Ce qu’on pourrait raconter à la place
Et si on élargissait le récit ? Et si on disait que l'économie de la vie, c’est aussi une industrie — au sens noble du terme : produire du soin, de l’attention, du savoir, de la durabilité ? Et si on orientait une partie des investissements massifs non pas vers des missiles longue portée, mais vers les filières du lien, de l’éthique, de la régénération ?
Ce ne serait pas seulement moralement souhaitable. Ce serait économiquement visionnaire.